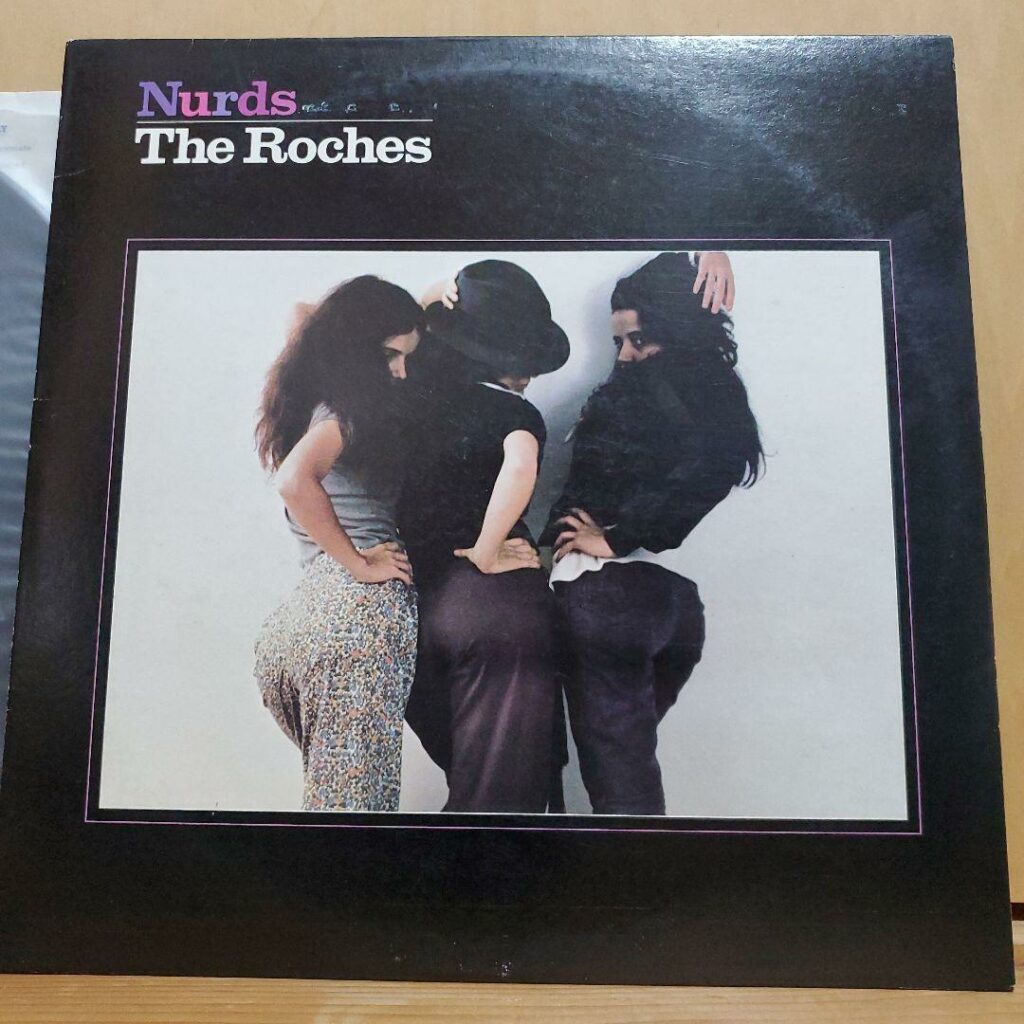J’entretiens avec Pharrell Williams un rapport pour le moins particulier. D’abord parce qu’il fut, au sein des Neptunes et de N*E*R*D, une figure centrale de mon adolescence, l’objet d’une passion qui s’est étendue sur presque dix ans, initiée en 2003 par la découverte du remix dans Daft Club et de tous les titres qui composent In Search Of…. J’imagine que l’on peut clairement parler d’idole, à ce stade. Il a par la suite été pour moi la source d’une amertume et de sentiments mitigés éprouvés tout au long de la décennie suivante, c’est à dire celle qui s’achève en ce moment même, à mesure que faiblissaient mon enthousiasme et mon admiration. Je ne souhaite pas forcément publier un article de fanboy, et encore moins rédiger une sorte de bilan ou de « nécrologie » détaillée, mais il m’importe néanmoins, alors qu’il semble de plus en plus obsolète, de pointer certains repères de sa trajectoire irrégulière.
Cela faisait déjà pas mal de temps que je ne le suivais plus qu’à distance, depuis le retrait progressif de Chad Hugo (l’autre moitié des Neptunes) et leur séparation officieuse. À vrai dire, j’avais pris mes distances avec tout ce qui concernait le rap et le R&B, lorsque les artistes et les maisons de disques ont commencé à privilégier StarGate, Lex Luger et Polow Da Don au détriment – à raison, parfois – de tous ceux que j’avais adulés des années durant (Timbaland, Just Blaze, Swizz Beatz, Jazze Pha, Scott Storch…). J’y suis revenu depuis, sans aucune aversion pour la plupart des nouveaux venus, et sans plus de regrets pour cette période dont j’estime qu’elle a fait son temps, je la considère à ce jour comme la meilleure de l’histoire du hip-hop et finalement tout me convient à peu près. À l’exception de Pharrell.
Je me rappelle, voici plus ou moins dix ans, avoir pu juger injuste son manque de notoriété, et avoir été contrarié par sa perte de créativité et son rôle éternellement secondaire. Il en est peut-être ainsi lorsque l’on s’attache à une personnalité publique : on prend les choses personnellement, quoiqu’à des degrés minimes. Puis en 2013, ce sentiment a mué en frustration lorsque Pharrell s’est retrouvé soudainement au sommet pour trois raisons : « Happy », « Get Lucky » et « Blurred Lines » ; trois titres symboliques, publiés la même année, à quelques mois d’intervalle, et dont il était entièrement, ou en grande partie, responsable ; trois titres pesants, aussi pénibles qu’ils furent spectaculaires, et qui allaient devenir, parmi d’autres succès, des classiques des années 10. Instantanément, Pharrell Williams allait être reconnu pour ces raisons précises, illégitimes car incroyablement réductrices, considéré comme un « nouvel artiste », comme celui « d’un seul hit », comme un second couteau définitif ; pire encore, l’auteur d’un titre sujet à polémique (« Blurred Lines ») ayant entraîné une condamnation sans précédent à la suite d’une plainte pour plagiat (un cas d’école fascinant, par ailleurs, questionnant les limites de la propriété intellectuelle et l’impossibilité de s’approprier un sentiment et de l’astreindre à un copyright). Et tout ceci sans qu’aucun lien ne soit fait (ou si obscurément) avec son passé : ni ses innombrables contributions, ni même ses apparitions les plus remarquées. Quelques mentions de ses featurings, tout au plus, sur « Beautiful » et « Drop It Like It’s Hot ». Le succès des trois singles mentionnés a entraîné la publication d’un deuxième album solo superflu, motivé par les requêtes de la Columbia et sans raison d’être, à la réactivation de N*E*R*D et au développement, toujours plus exaspérant, d’une persona sans saillies, lisse et démagogique (le single suivant, littéralement inécoutable, était une ode à la liberté), nourrie de cette transparence et de cet optimisme qui assurent, traditionnellement, une certaine commodité aux pop stars. Williams est définitivement tombé dans une espèce de domaine public, et s’y est dissous progressivement, j’ai envie de dire chichement, dans une certaine indifférence.
Plus frustrante encore pour moi a été la dissolution du son Neptunes. Les sonorités des nouvelles productions de Pharrell m’ont toujours paru génériques ; il n’y a plus de place pour les étrangetés et les audaces formelles auxquelles j’avais été habitué, et si c’est parfois le cas, c’est au profit de quelque chose de faussement ludique, comme sur « Stir Fry » de Migos ou « Yellow Light » (pour la BO de Despicable Me 3). Presque tout sonne comme Random Access Memories, presque tout y est anodin. La production et le mixage y sont excessivement polis, sans ingéniosité. Je ne souhaite pas non plus être catégorique ni de mauvaise foi : il y a eu une poignée d’essais assez incroyables, notamment pour Lil Uzi Vert (« Neon Guts »), Ariana Grande (sur l’album Sweetener), Frank Ocean (« Golden Girl », certains diront « Pink + White ») ou Pusha T (« Suicide »), voire même, dans une certaine mesure, des titres signés pour Kendrick (« Alright », qui reprend à peu près la même structure que « Presidential » de Rick Ross, qu’il produisait trois ans auparavant), pour lui-même (« It Girl ») ou le dernier Kid Cudi (« Surfin » par exemple, mais pour le coup, je pense que ça fonctionne surtout grâce à la voix de Cudi, à son extase béate hyper communicative et à sa façon de poser sur l’instrumental, plutôt qu’à l’instrumental en lui-même). Je déplore simplement sa perte d’intensité, de pertinence dans ses apports, et il peut être contrariant, quelque part, de voir un de ses fétiches s’étioler ainsi, dénaturé et dépossédé de ses qualités, par un succès commercial que personne n’avait anticipé et qui n’avait vraisemblablement jamais été prévu par l’histoire.
À l’inverse d’une multitude d’artistes, je doute fort, hélas, que sa popularité ne dépasse, à l’avenir, ses succès récents. Et je ne crois pas que ses travaux prennent de l’ampleur à mesure que l’on s’éloigne de l’âge d’or dont je parlais en début d’article. Car Pharrell Williams s’est toujours retrouvé dans un entre-deux confus, bien trop réputé et notoire pour attiser le travail de mémoire (en dehors de certaines listes sur Internet, classant les vingt ou les cinquante meilleures productions des Neptunes), et trop peu réputé et notoire pour permettre des rééditions régulières, sous forme de coffrets et d’anthologies, selon l’exemple des Beatles ou de Pink Floyd. Il a principalement agi en tant que compositeur, mais s’est hissé à un rang plus reconnu, en apparaissant lui-même sur les titres qu’il produisait, malgré l’insuffisance de son chant, et particulièrement de son falsetto.
Le parcours de Pharrell est chargé d’anomalies. À l’époque, son unique single (« Frontin », parmi ce que les Neptunes ont produit de plus miraculeux) avait servi à la promotion d’une compilation signée par les deux producteurs (Clones), auquel succédait un unique album (In My Mind, publié en 2006 et produit en solo), qu’il n’évoque quasiment jamais et dont il ne joue jamais les titres en live, honteux, probablement, de son échec commercial et critique. Cet essai devait être à la mesure de son ambition, et il n’a désormais pour lui plus la moindre considération. Au grand dam de ses adorateurs, Tyler, The Creator notamment – le plus à même (le seul ?) de revendiquer l’héritage de Williams (il faut le voir imiter sa gestuelle et ses expressions, par moments) –, auteur d’albums qui me réjouissent et ravivent aujourd’hui mon intérêt, en occupant une place laissée vacante. Tyler s’est d’ailleurs plaint, à un moment, du mépris de Pharrell pour une œuvre qui avait tant compté pour lui, et avait écrit un long post Facebook pour le dixième anniversaire de l’album, ajoutant qu’il avait décidé de fonder Odd Future après l’écoute de « You Can Do It Too ».
Les deux en ont probablement discuté en privé, mais Pharrell ne s’est jamais trop exprimé à son sujet. Il avait juste refusé de s’aventurer une nouvelle fois en solo (c’était avant 2013), mais proposait tout de même, en 2007, à ?uestlove et James Poyser, de retravailler son essai, et déclarait, à l’écoute du résultat, qu’il s’agissait exactement de ce qu’il avait en tête au moment de concevoir In My Mind. L’album ainsi revu n’a jamais été publié officiellement : il n’en existe que des bootlegs, que d’aucuns considèrent comme suffisants et largement supérieurs à l’original. Je ne suis pourtant pas surpris que Williams n’ait jamais considéré véritablement la dite révision, Out Of My Mind, signée sous le nom des Yessirs, tant elle diffère (subtilement) de son prédécesseur, et contredit son perfectionnisme. J’apprécie énormément les deux versions, sans chercher à les opposer réellement : c’est simplement qu’il est toujours réjouissant de comparer des originaux que l’on a aimés et écoutés des centaines de fois à des dérivés d’une vision, disons, divergente. Il y a des titres plus décevants dans l’un et l’autre, d’autres absolument merveilleux, parfois dans les deux cas (« I Really Like You Girl », « That Girl », « Number One »), et des opposés complets, comme « Baby », que je ne supporte pas dans In My Mind et qui s’avère tout simplement être le meilleur titre de la seconde version. Ce pourrait être en somme un « album anti-Pharrell », dans le sens où il sonne quasiment live, privilégiant une sorte de spontanéité et de sûreté modeste. Il est en opposition à l’ampleur, aux enjeux et à l’ambition « prime time » de Williams sur In My Mind. Le clinquant n’y est plus, une légère clarté, une douceur de fin d’après-midi s’y est substituée. Je devrais même parler de limpidité, c’est exactement le mot qui lui convient : c’est un son excessivement limpide, d’une remarquable fluidité. Et elle comporte surtout un inédit, « Creamsickle » , un titre mentionné plusieurs fois par Pharrell lors de la promotion de l’album, exclu finalement du tracklist (ça valait bien la peine d’en parler autant aux journalistes !), dont on ne connaît que la version de ?uestlove/Poyser et sur laquelle Pharrell n’avait jamais semblé emprunter autant à Prince.
Bon, ce n’est peut-être pas très malin de choisir de parler d’un « album anti-Pharrell » lorsque l’on souhaite s’attarder sur son cas et l’exposer sous un meilleur jour, mais j’aime à croire qu’il n’est qu’une fantaisie de plus dans sa discographie et dans son parcours, et qu’il en dit finalement peut-être aussi peu sur son envergure qu’une écoute de GIRL, pris à part, mais ça vaut aussi pour In My Mind, les productions des Neptunes ou les albums de N*E*R*D. Je veux dire par là qu’il n’y a probablement aucun portail véritable, aucune introduction idéale ou évidente à l’œuvre de Pharrell Williams, que sa densité et surtout sa multiplicité nous oblige à y puiser un peu partout, et parfois même à l’explorer au-delà des sorties officielles, comme ce peut être le cas pour Out Of My Mind ainsi qu’une quantité infinie d’unreleased indispensables (ceux d’Usher en premier lieu). Et l’effort doit malheureusement être individuel tant la réhabilitation paraît hasardeuse.