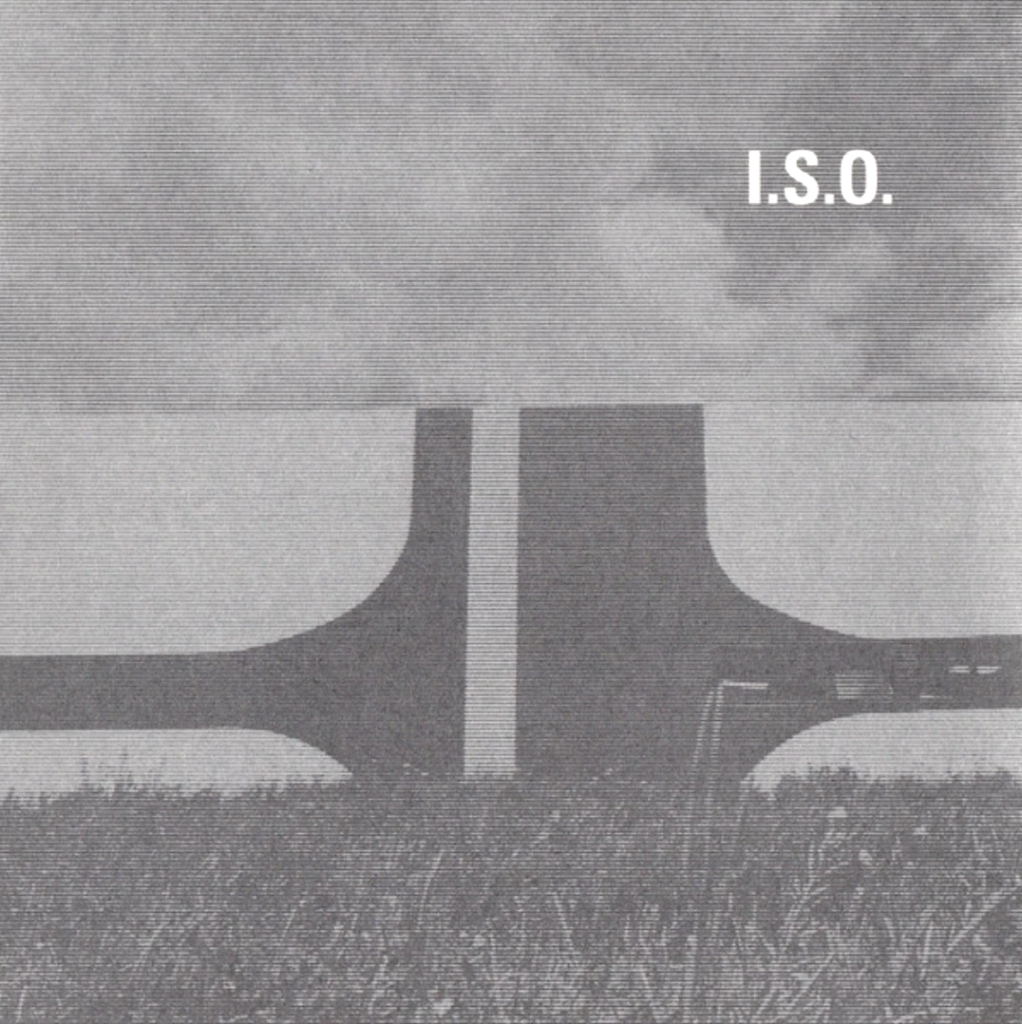Je voudrais vous parler aujourd’hui du travail d’une musicienne fascinante et acharnée, excellant dans toutes les étapes d’un chantier sonore total – de la démolition à la déco en passant par le gros œuvre, si on veut filer la métaphore.
Si Sachiko Matsubara n’est pas n’importe qui – elle a joué avec un nombre important de grosses pointures, a participé à l’aventure Ground Zero, le groupe de son camarade maboule de toujours, Otomo Yoshihide –, il est surtout important de noter qu’elle ne fait pas n’importe quoi. Là où certains de ses collègues se dispersent et se dissolvent dans l’expérimentation, Sachiko a fait un choix : n’utiliser qu’un outil, le sampler (et même uniquement un modèle, le Akai S20 il me semble, sorti en 1997) et les sonorités-tests de celui-ci. Du sampling sans samples et sans mémoire tampon, donc. Quasi-exclusivement, depuis bientôt 25 ans.
De ce cadre (très) restreint et à première vue pas franchement émancipateur, la musicienne japonaise réussit cependant à créer un univers sonore marqué à la fois par une extrême pauvreté et une précision tout aussi importante. En jouant sur de parfois très longs silences et avec des sons de synthèse assez génériques, sa musique engage dans un processus d’écoute exigeant : à la fois par l’attention qu’elle demande à l’auditeur et par les sonorités souvent précises et insoutenablement nues qu’elle emploie. Du presque rien bruiteux et pur, trop pur, constitué d’éléments identifiables (longs bourdons monofréquentiels, matières glitchées, amas d’objets sonores), souvent éloigné du royaume de l’harmonie traditionnelle : je sais que je vais en faire rêver certains et fuir d’autres, mais au moins c’est dit.
Mais malgré son austérité apparente, la musique de Sachiko M n’est pas qu’une suite d’expérimentations pragmatiques à la John Dewey. Elle façonne aussi des mondes esthétiques avec des repères et une grammaire propres, un cosmos incontestablement ascétique où de sombres fables machiniques nous sont contées. Un cosmos fonctionnant aussi bien en autonomie qu’en symbiose – peut-être même plus dans ce dernier cas de figure, selon moi –, lorsque la japonaise collabore avec d’autres artistes.
En solo, sa focalisation sur des éléments et évènements réduits, bien que virtuose, peut s’avérer éprouvante à l’écoute sur le temps long. Son album Sine Wave Solo en est un exemple parfait : Sachiko n’y réalise absolument aucune concession, mettant en place des miniatures plus ou moins longues mais toujours radicales, où les variations prennent forcément des proportions dantesques. Une musique de détails mais sans profusion, corporelle, s’écoutant très fort mais aussi a très faible volume – je recommande les deux configurations, ça mobilise l’attention et les tripous de manière très différente !
Il y a aussi évidemment quelque chose de très japonais dans cette pratique, que l’on pourrait rapprocher de la contemplation du réel comme une totalité / continuité fluide, toujours dans une optique de non-segmentation entre l’artificiel et le naturel, le synthétique et le « vrai ». Un holisme où l’individualité se dissout partiellement – la généricité de sons maniés avec habilité, mais aussi d’un nom en partie anonymisé. Mais je vais en rester là et ne pas emprunter ce chemin casse-gueule, je ne suis pas un pro en la matière et laisse donc ça à mes noiseu·ses nippophiles expert·es.
Pour moi, c’est cependant collectivement que la pratique de cette artiste prend toute son ampleur. Deux créations, assez différentes, illustrent le côté couteau-suisse de cette dame à la classe innée : Happy Mail, réalisé avec son trio Hoahio (comptant la multi-instrumentiste et chanteuse Haco et la joueuse de koto Michiyo Yagi) et I.S.O., second album studio du groupe éponyme qu’elle forme avec Otomo Yoshihide et Yoshimitsu Ichiraku. Sa pratique reste fondamentalement la même à chaque fois, mais s’adapte parfaitement à chaque projet. Au-delà du caractère commun des sons qu’elle utilise, c’est sa connaissance de ceux-ci qui l’amène à toujours les agencer parfaitement, d’être dans l’économie plutôt que dans la logorrhée. Juste comme une instrumentiste accomplie, en fait : et c’est ainsi qu’il faut appréhender son boulot je crois, comme une musicienne explorant les possibilités d’un instrument-dispositif dont elle a posé les frontières et les modes de jeu.
Sur Happy Mail par exemple, cette saillie improbable, décousue et jouissive, elle se fait parfois très présente, parfois quasi-invisible, mais ne se place jamais au-dessus. Ce qui compte, c’est la mise en place d’un commun, que ce soit une ambiance (« Ricardo Sex » et cet ostinato qui nique complètement la tête sur 8 minutes), une chanson (« Less Than Lovers, More Than Friends », ce tube d’indie-rock parfait) ou… autre chose (« Low Tech »). J’aime particulièrement cet album parce qu’il est tout simplement chouette, faut le dire ; mais aussi parce qu’il montre une autre facette de Sachiko, peut-être moins « musique de recherche pour 50 pélos fans d’électro-acoustique » (dont je fais partie, y’a pas d’embrouille) et plus « groupe avec de vraies femmes dedans », même si on est clairement encore dans le bizarre, mais un bizarre plus chaleureux, comme une tata restée collée aux acides, super fun et même classe, par moment.
Avec I.S.O., changement d’ambiance, encore. On entre dans quelque chose de bien moins « pop » et bordélique : c’est chirurgical et hanté, plein de matériaux étranges, d’échos de marécages, de muqueuses et d’industries en train de péricliter. Il me semble qu’ici, entourée de deux autres forcenées, Sachiko est en mode apex predator, les sens en éveil, prête à fondre sur chaque nouvelle variation de ses collègues. L’album est divisé en quatre plages d’une dizaine de minutes chacune (avec une dernière qui est quand même plus frontale et moins « fusionnelle » : ça fait plus agrégat d’individus qui jamment que nouvel organisme), comme autant de dérives autopoïétiques se répondant. Otomo Yoshihide a considéré cette œuvre comme l’une de ses plus importantes, et on ne peut que le comprendre. Le résultat est pas mal paysager sans faire « paysage sonore » (désolé Murray Schafer). On est pas dans l' »ambiance cinématographique » non plus – et heureusement, je suis sûr que ça me vaudrait une retenue sur salaire –, mais dans autre chose. Un « autre chose » ample et tout en finesse, où l’on peut se mouvoir et se perdre, comprendre de travers, se faire surprendre.
J’invite les courageux·ses à écouter ces trois albums donc, mais aussi toutes les autres sorties de Sachiko (j’ai mis plus haut le lien vers Salon de Sachiko, un album de 2007 qui vaut vraiment le coup), il y a de jolies choses, bouleversantes même, comme sa collaboration avec Philip Samartzis, parfaite pour s’infléchir doucement, ou méditer même pour celles et ceux qui pratiquent, sans pression ; prendre compte de sa singularité pas si singulière que ça, de son appartenance à une communauté d’altérités radicales, aussi.