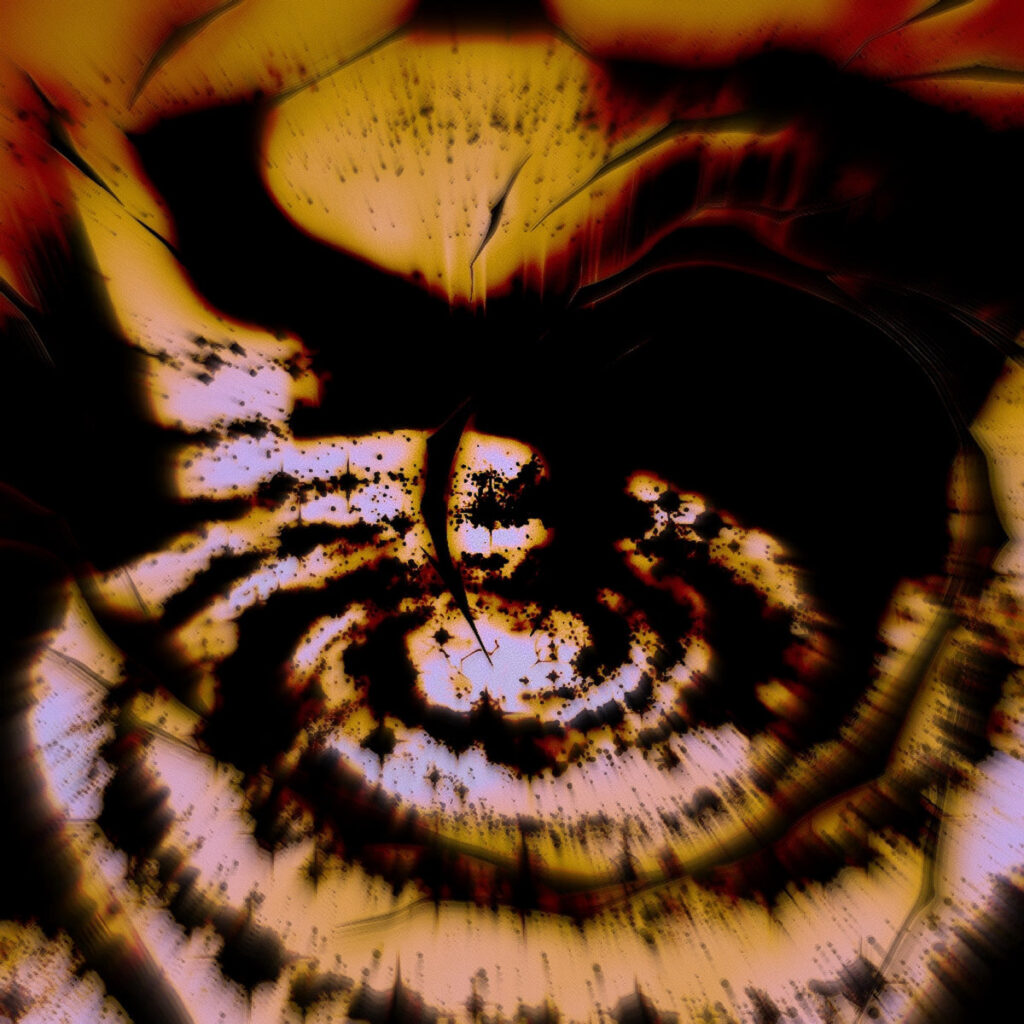Depuis la semaine dernière, la Bibliothèque municipale de Lyon accueille l’exposition « Contre-Bande : musiques alternatives et culture cassette en Auvergne Rhône-Alpes 1980-1999 », dont le commissaire s’appelle Simon Debarbieux. Vous connaissez peut-être déjà le nom de Simon car il est par ailleurs co-fondateur de LYL radio et auteur de trois anthologies mémorables sorties ces dernières années : Mahgreb K7Club avec Péroline Barbet, chez Bongo Joe à Genève, qui s’intéressait déjà à la région AURA puisqu’elle rassemblait des extraits de cassettes de raï publiées à Lyon dans les années 1980, et sur Sofa Records (label affilié au disquaire lyonnais du même nom) la compilation Wallay ! qui regroupait d’obscurs enregistrements exhumés cette fois-ci au Niger, là aussi entre autres au format cassette, ainsi qu’une mixtape qui marquait le début de son exploration de la cassette culture française, puisqu’elle était consacrée à Organic Tapes, label grenoblois à la sensibilité indus mais néanmoins très ouverte, voire carrément chaleureuse.
« Contre-Bande » se présente comme une plongée dans cette scène DIY multi-supports, passée presque entièrement sous les radars et pour cause : ses acteurs et actrices, en général issu·es du punk et ayant pris le virage indus, refusaient toute médiatisation/marchandisation de leur musique et ne passaient donc jamais par les circuits habituels de distribution, leur canal principal, c’était le courrier.
On peut déjà se réjouir de voir des institutions publiques décider de consacrer de l’espace, de l’argent et de l’énergie à un phénomène aussi underground. C’est vraiment une bonne nouvelle d’apprendre qu’il existe des « décideurs culturels » qui ne vous font pas des sourires crispés quand vous leur amenez un truc dont ils n’ont pas entendu parler cinquante fois sur France Inter ou dans Les Inrocks. Mais si j’ai bien compris, les gens de la Bibliothèque municipale de Lyon n’ont pas attendu cette expo pour montrer qu’ils s’attachaient à la préservation du patrimoine local le plus confidentiel, et pour ça on leur dit bravo, ça c’est mes collectivités territoriales !
Et ce sont dans ces conditions de travail quasi utopiques que Simon Debarbieux a pu développer sa recherche, toujours très orientée sur le format cassette, donc, et mettre en lumière ces réseaux de mail art français (aux ramifications souvent européennes) où circulaient de la musique si inouïe qu’on a du mal à imaginer, trois voire quatre décennies plus tard, qu’elle ait pu exister en France. J’exagère sans doute un tout petit peu, on sait que l’Hexagone a été assez actif en matière d’avant-prog ondulant de la toiture, d’ambient pour caves humides et de minimal synth en décompensation, mais ça n’empêche que j’étais ébahi en écoutant les deux émissions pour LYL que Simon a faites à partir de ses trouvailles. Ça va du punk le plus lo-fi à l’indus le plus désorientant, en passant par des plages synthétiques faussement apaisées, ainsi que quelques chansons en français qui ne seront jamais reprises dans The Voice. Et surtout, toute cette grisante activité sonore était assortie d’une tout aussi grisante activité plastique, puisque le mail art impliquait forcément de prendre soin de l’emballage, jusqu’à, vous l’avez compris, envisager la cassette elle-même comme faisant partie de l’œuvre, et à fabriquer zines, flyers, dessins, collages, etc.
J’ai posé plein de questions à Simon pour qu’il nous introduise à cette scène jusqu’ici jamais documentée, et il ne s’est pas gêné pour me répondre exhaustivement.
L’expo dure jusqu’à la fin août, et si vous êtes de ou dans la région, allez donc la voir, c’est gratuit et c’est super !
Comment t’est venue l’idée d’une expo autour de la culture cassette et de l’underground punk/indus/diy régional ?
Ça s’inscrit dans un parcours plus global. J’ai fait des études d’anthropo musicale et depuis mon arrivée à Lyon, que ce soit via la webradio LYL que j’ai cofondée ou le magasin de disques avec lequel je bosse (Sofa Records), je me suis toujours intéressé aux initiatives locales, passées comme présentes, et j’ai donc exploré aussi tous ces blogs qui mettaient à disposition en téléchargement des musiques parues sur cassettes dans les années 80. J’ai découvert par ce biais des productions issues de cette scène (qualifiée de post-indus dans un superbe article de Christophe Brocqa/Tristan Koreya et Vincent Douris), particulièrement intéressante dans la région. De fil en aiguille, j’ai rencontré Didier Gibelin d’Organic Tapes, récupéré ses cassettes et tout numérisé. Je me suis dit qu’il y avait un truc à faire. J’ai monté un dossier et demandé une subvention (à la région et à la DRAC).
Comment tu t’y es pris pour convaincre des institutions publiques de s’intéresser à des choses aussi peu connues et aussi peu intégrées au patrimoine culturel ?
Justement, en mettant en avant l’ampleur de cette méconnaissance et du désintérêt patrimonial, malgré leur potentiel : cette scène avait été plutôt foisonnante dans la région et elle était connectée à un réseau bien plus vaste ! Elle touche donc à des problématiques locales et internationales.
Aussi, on a parfaitement accepté la patrimonialisation du punk : il a sa place, en tant qu’objet d’étude, dans toutes les institutions françaises, on le considère responsable de toutes les (r)évolutions musicales des décennies qui suivent. Mais on oublie complètement les autres mouvement musicaux de cette décennie – et plus particulièrement la musique industrielle. Ce mouvement précède le punk (~1975) et porte des préceptes bien plus radicaux (à mon sens).
Bref, il s’agissait aussi de complexifier un peu le récit, recentrer le viseur, et de remettre en question ce qui constitue habituellement l’objet des institutions patrimoniales.
Sans rentrer dans le détail, comment as-tu organisé les choses avec la Bibliothèque municipale de Lyon et la région ? Les budgets viennent d’où ?
J’ai contacté la BM très tôt, quand je mettais en place mon idée. Cyrille Michaud, responsable du département musique, a immédiatement montré un intérêt pour le projet, et l’a porté devant ses supérieurs.
Il faut aussi savoir que depuis dix ans, la BM alimente un fonds d’archives musicales focalisé sur la scène locale : ils achètent ou récupèrent toutes les productions, passée ou présentes, de l’agglomération lyonnaise.
Quels contacts as-tu liés avec les artistes et activistes de cette scène ? Comment ils réagissent à ton initiative ?
Les contacts ont été plutôt faciles. J’ai fait des super rencontres ! Ces gens sont, le plus souvent, restés très fidèles à leurs personnalités de l’époque. Des gens vrais, accessibles, bienveillants et généreux – matériellement autant qu’affectivement. Quelques archivistes rigoureux, avec une mémoire de dingue. Pas de mauvaises surprises. Franchement, j’ai été gâté.
La plupart on été séduits, plutôt enthousiastes. Ils étaient ravis qu’on parle enfin de cette scène-là, qui a été pour eux une expérience de vie inoubliable, et dont ils gardent de beaux souvenirs, et parfois des amitiés durables. Ça a aussi souvent été le point de départ de longs itinéraires dans la musique, la peinture, l’illustration, le graphisme… Leur proposer une expo sur cette histoire, ces histoires, c’était pour eux une super nouvelle.
Certains ont accueilli ça avec plus de réserves – notamment à l’égard des institutions culturelles, et de l’indifférence que celles-ci ont manifesté envers leurs productions à l’époque. Mais eux aussi ont pour autant toujours été généreux et bienveillants.
Un certain nombre d’artistes qu’on entend dans tes émissions pour LYL sont visiblement introuvables/incontactables, c’est presque devenu rare à notre époque, est-ce que tu continues de les chercher ?
Effectivement, il est plus facile que jamais de retrouver des gens. Mais ce réseau, géographiquement très étendu, comptait un nombre assez limité de personnes. La plupart se connaissaient. C’est donc facile de passer directement par les acteurs de cette scène, qui peuvent te donner des détails qui t’aiguillent.
En ce qui concerne la région, je pense en avoir retrouvé pas mal… en tout cas des principaux acteurs, ceux qui avaient des labels notamment. C’est rare que les gens se volatilisent dans la nature… à quelques exceptions près – et j’en parle dans l’émission justement. J’adore ce genre d’anecdote !
Cela dit, depuis que l’expo a ouvert, on m’a contacté à plusieurs reprises pour me transmettre des publications, des cassettes, etc. dont je n’avais pas connaissance auparavant.
Comme tu le dis au micro de LYL, les styles balayés sont assez variés même s’ils ont un tronc commun lo-fi : en gros c’est quoi les carrières des gens que tu as pu identifier ? Il y a des plasticiens, des compositeurs plus académiques, des entristes pop ?
Leurs parcours sont très variables, mais peu d’entre eux sortaient d’écoles d’art ou de longues études. En réalité, cette scène a surtout touché des personnes issues des classes populaires, plutôt que moyennes ou supérieures – même si ce constat reste assez schématique. Le terme « indus » fait directement référence à une histoire, à la composante populaire justement.
Donc c’est plutôt des gens qui se mettent à bosser jeunes mais qui ont ce désir inaliénable de créer, de faire des choses. Certains ont un vrai parcours dans le milieu des squats ou des espaces autogérés, mais pas tous. Tu as aussi des experts comptables qui font de la musique concrète, des contrôleurs des impôts qui sont fans d’art médical et tout ce qui touche à la contre-culture. Je trouve ça d’autant plus intéressant !
Leurs parcours, si on s’en tient à la musique, sont restés assez confidentiels ; quelques-uns d’entre eux ont fait de petites carrières – ou sont reconnus à l’international pour ce qu’ils ont fait, ou ce qu’il font aujourd’hui. Par exemple, Lieutenant Caramel est une figure de la musique concrète ; Jérôme Noetinger aussi.
Tu fais une expo avec l’aide de pouvoirs publics sur une scène qui au cours de son existence se développait complètement en marge, est-ce que tu ressens comme un paradoxe le fait de la faire accéder au patrimoine ?
Carrément, c’est un exercice délicat. Mais c’est aussi celui de mon parcours : j’ai toujours trouvé du bon dans les deux, sans jamais me situer complètement d’un côté ou de l’autre. Et en France il faut dire qu’on a un gros, gros problème pour joindre les deux – ce qui est beaucoup moins problématique dans les pays anglo-saxons, par exemple. Il y a aussi des acteurs qui m’ont souligné ce paradoxe, m’ont demandé de le prendre sérieusement en compte dans le cadre de l’expo.
Pour ma part, je pense qu’il est important de rendre accessible cette partie de l’histoire musicale au plus grand nombre – des scènes de niche certes, mais dont les discours sous-jacents sont très intéressants à saisir. Beaucoup d’individus ne vont pas aller d’eux-même vers ces esthétiques, ces productions culturelles, pour tout un tas de raisons, et la rencontre entre ces champs (l’académique et l’alternatif) permet ces rencontres, ces croisements. Il faut les considérer comme des vases communicants, faire en sorte de générer ces interactions, ces échanges. Cesser de laisser les académiques avec les académiques, les alternos entre eux.
L’entre-soi, c’est pas toujours constructif, c’est l’échange et la confrontation qui permettent aussi d’avancer, la rencontre avec la différence.
Pour parler concrètement : la BM à Lyon est un lieu ouvert, pensé pour la consultation d’archives, le prêt d’ouvrages et l’organisation d’évènements, mais aussi pour accueillir des gens qui n’ont pas nécessairement d’autres endroits où aller, des gens qui n’ont pas d’ordinateur ou Internet à la maison. La dimension sociale de ce lieu est très importante. Pendant l’accrochage de l’expo, il y a plein de gens qui sont venus nous parler, nous poser des questions parce qu’iels étaient surpris·es, intrigué·es, ou touché·es par les objets qu’on accrochait au mur. C’est aussi là qu’il se passe quelque chose, à mon sens.
Peux-tu parler de l’aspect visuel/mail art qui compte énormément dans cette scène ? Est-ce que tu dirais que c’est carrément indissociable de la musique, et que c’est d’ailleurs ce qui justifie d’en faire une expo plutôt qu’une simple sortie de disque ?
Oui. La musique, c’est le prétexte principal, la raison d’être de cette scène mais les acteurs font usage de pleins d’autres médiums artistiques. Ce qui caractérise cette scène c’est plutôt une manière de faire, des logiques sociales communes. Les pièces présentées sont assez hétérogènes : tu as du son, de la vidéo, des dessins, des collages, de la photographie, de la sculpture, du copy art, de la littérature, de la poésie… Et au sein de ces médiums-là, les expressions sont aussi très diverses. Tout est à la fois support de et prétexte à la création – et ces acteurs ont vraiment fait preuve d’une inventivité débridée.
Ensuite, il faut se rappeler que les cassettes circulaient via le service postal. Ça permettait à la fois de faire partie d’une communauté plus vaste et d’avoir accès à des contenus culturels très peu diffusés à l’époque. Certains te diront que le début des années 80, c’était un désert, culturellement parlant. Il fallait faire les choses soi-même. L’intrication de cette scène au réseau préexistant du mail art est donc fondamentale. Cette forme artistique est d’ailleurs utilisée par les premiers instigateurs du mouvement indus (Coum Transmission/TG). Die Form, à Bourg-En-Bresse, communique dès 1977 avec Genesis P-Orridge.
Dans ses préceptes, le mail art rentre en parfaite symbiose avec ceux de la musique industrielle : c’est une forme artistique qui est collective par essence, et d’inspiration libertaire. Elle remet en question les valeurs du monde de l’art (marchandisation des œuvres, valeurs bourgeoises élitistes, institutions culturelles comme seuls espaces de représentation de l’art) et du statut de l’artiste (tout le monde peut en être un).
En plus des cassettes, les acteurs rivalisaient d’imagination pour proposer des supports leurs permettant d’augmenter leur réseau de contacts et diffuser leurs musiques : fanzines évidemment, mais aussi press books illustrés, catalogues de vente par correspondance, invitations à contribution pour des compilations internationales, flyers… Je croulais sous les archives à exposer, et le choix des pièces n’a pas été évident !
Et j’en profite quand même pour souligner que je travaille actuellement sur une compilation !
Dans le lot, c’est quoi tes artistes et/ou morceaux préférés, ou du moins les choses que tu recommanderais « en introduction » aux gens qui découvrent ce monde ?
Pas évident de répondre à cette question. S’il s’agit d’une accroche – et donc des morceaux/groupes/projets les plus pop/accessibles, je dirais :
Pour les labels, indiscutablement RR Product (et la compile Disco Totem vol. 1), Organic Tapes (les compiles Passions Organiques ou CONAPT), Underground Production (la compile How To Become a Millionnaire).
Pour les formations musicales/musiciens : Los Paranos, Cripure SA, In Aeternam Vale, Cha Cha Guitri, Cri Primal (que j’ai découvert tout récemment).
Est-ce que tu voudrais inscrire ta démarche dans une dynamique plus générale d’amendement voire de réécriture de l’histoire musicale française ? En particulier du punk et des musiques électroniques ?
Ce serait prétentieux de ma part de vouloir faire ça. Et puis c’est pas mon boulot.
Ce qui est certain, c’est que le punk a pris toute la place dans les discours autour de la contre-culture des années 70, et des expressions culturelles qui ont suivi. Aussi dans le monde académique : l’université de Tours a lancé un grand projet de recherche et d’archivage sur le punk… Et on ne compte plus les spécialistes sur la question, ni les ouvrages qui sont publiés chaque année. C’est un mouvement qui a été, dès les débuts, très médiatisé, notamment grâce à des figures emblématiques et à une proposition esthétique très forte. Mais il a aussi eu tendance à prendre toute la place : on dit souvent que le président élu est celui qui passe à la télé.
Si ce mouvement a marqué toute une génération, une époque, il n’est pas le seul – ni le premier – à avoir voulu déboulonner l’héritage des années 60 et début 70. Le mouvement de la musique industrielle a une importance fondamentale et précède le punk d’un an au moins (1975). La no wave arrive après et, malgré son existence très brève, a considérablement marqué des générations de musiciens.
Comment circulaient concrètement ces cassettes ? Comment étaient choisis les destinataires ? C’était des échanges, des dons, des ventes ? Elles n’étaient pas du tout distribuées autrement ?
Les cassettes circulaient surtout par la poste. Cette scène est décentralisée et épistolaire : les acteurs agissent autant depuis Paris ou Grenoble que depuis Boulazac, dans le Lot ou Annonay, en Ardèche. Elle est structurée en réseau – et pour faire partie du réseau, il fallait être actif. Ça, c’est l’héritage direct du mail art.
La plupart sont rentrés dans ce réseau de la manière suivante : ils ont acheté un disque, une cassette ou un fanzine dans lequel était inséré une liste de contacts. Ils envoyaient 2, 3 lettres – un mec répondait, puis l’ajoutait à sa liste de contacts… En deux temps trois mouvements, certains me racontaient crouler sous les envois postaux et sous la charge de travail que ça représentait d’y répondre !
Les cassettes passaient aussi – mais dans une moindre mesure – de la main à la main, dans la vie de tous les jours ou lors de petits événements (quelques mini-festivals, concerts, expositions, etc.). Elles pouvaient être mises en dépôt-vente dans des magasins de disques (Bunker Records à Grenoble, Central Service à Lyon, ou New Rose à Paris…) ou dans quelques rares lieux alternatifs. Mais ça reste minoritaire : le principal canal d’échange, c’est le service postal.
Ces objets servaient beaucoup plus de monnaie d’échange. Cette scène se positionnait contre la marchandisation de la musique – et de l’art d’une manière plus générale. Il fallait créer et produire pour échanger, pas pour générer du profit. Le fascicule d’un label orléanais stipule : « Emergence du Refus préfère l’échange ». Cet aspect est fondamental.
Ces gens étaient curieux, en demande d’une nouveauté radicale. Ces musiques n’étaient pas diffusées dans la plupart des points de ventes habituels – et YouTube n’existait pas, évidemment… La circulation des cassettes, c’était l’une des seules possibilités d’entendre des sons nouveaux, incongrus, radicaux…
Chez les artistes que tu as rencontrés, quelles sont les inspirations (musicales ou non) qui reviennent le plus souvent (à part les Residents !) ?
Crass, Luigi Russolo, TG, Cabaret Voltaire, les Stranglers… et oui, les Residents !
Bibliothèque Part-Dieu – 30 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon Jusqu’au 25 août 2023