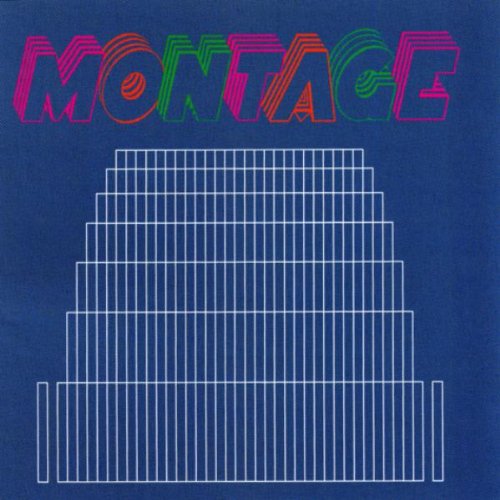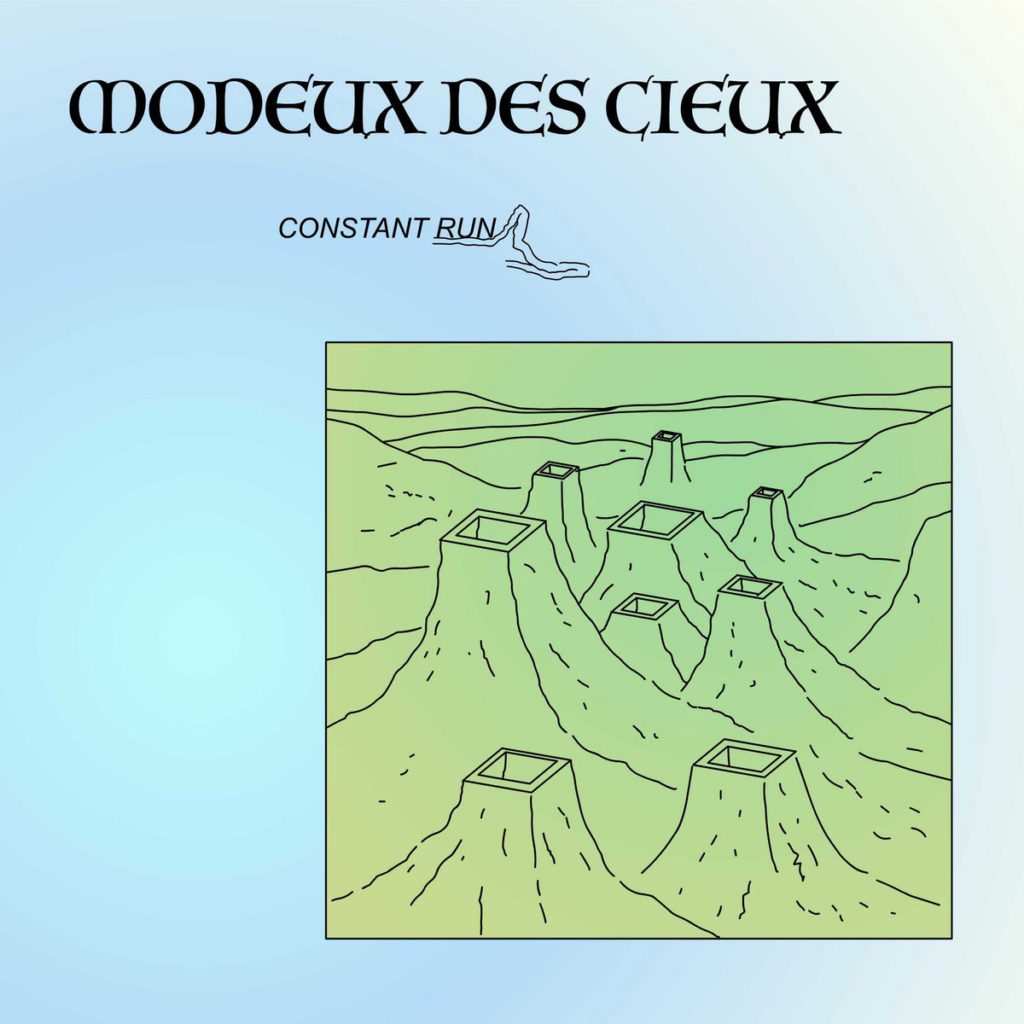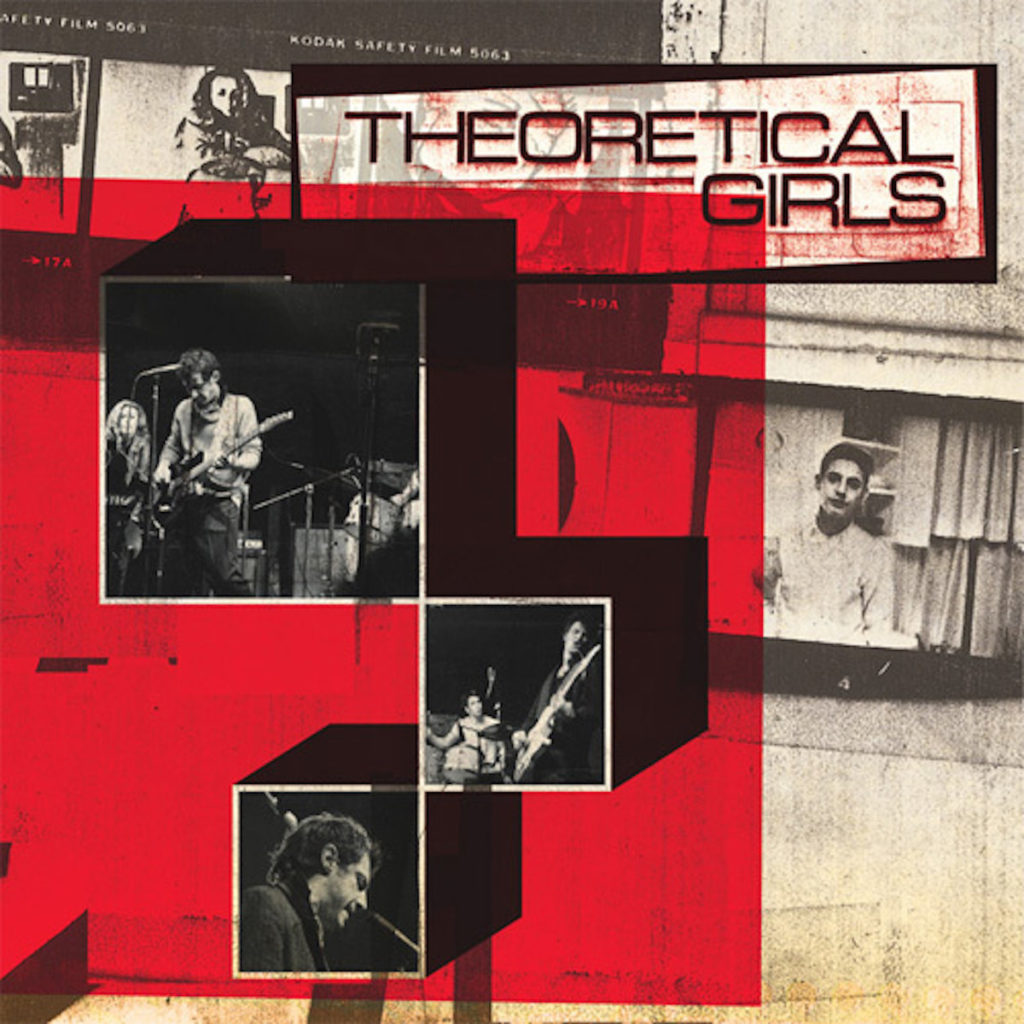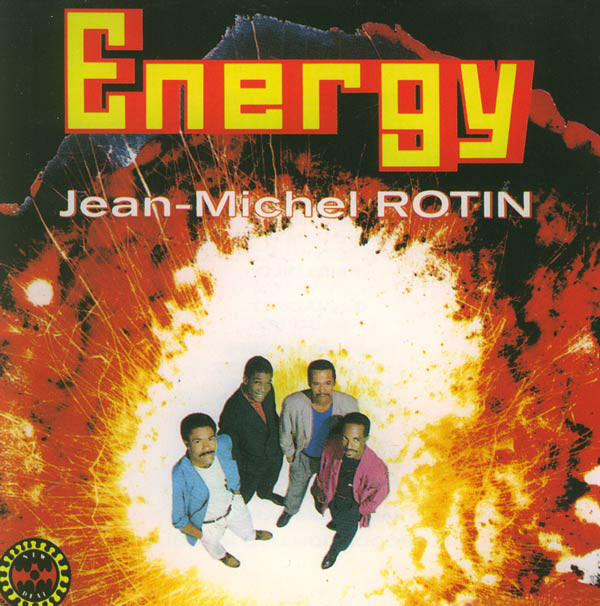Les connaisseurs et connaisseuses connaissent souvent Montage, encore plus souvent Left Banke, et peut-être un peu moins Stories et The Beckies, c’est-à-dire les différents projets de Michael Brown, New-Yorkais talentueux et plus ou moins « fils de » puisque son père (qui d’ailleurs portait un nom beaucoup moins chiant que le sien : Harry Lookofsky) était violoniste de session et dirigeait un studio d’enregistrement. La carrière de Brown ressemble à une suite de mauvais choix et d’échecs et ça ne m’étonnerait pas que le mec, mort en 2015, ait été le genre de petit génie insupportable qu’on croise hélas trop souvent dans le milieu de la musique, mais séparons l’homme de l’œuvre et la vérité du préjugé pour considérer ses travaux, qui comptent parmi mes disques de « classic pop » préférés, que je place au même niveau que les Beach Boys, les Beatles, Love, Todd Rundgren ou les Zombies, et parfois même au dessus. Les chansons de Montage, en particulier, dégagent une impression de vulnérabilité et de délicatesse évidente tout en prenant des chemins et des détours extrêmement courageux, osés, voire téméraires, et du coup ça donne un résultat qui fond l’un dans l’autre la force et la faiblesse, dont on ne sait trop s’il est la plaie ou le coutelas. Déjà sur les disques de Left Banke, Brown cultivait un goût pour les instruments inhabituels dans la pop, à commencer par le clavecin, ce qui valut à sa musique le qualificatif légèrement abusif de « baroque » (Jean-Seb aurait adoré). Sur cet album de Montage, il se la donne à fond, à base de chants-contrechants dans tous les sens, de pianos virevoltants, de contrepoint et basse continue en-veux-tu-en-voilà, de rythmiques en retrait mais néanmoins toujours très fermes, en fait le côté fragile du truc n’est qu’une vitrine car en réalité ça groove vraiment bien, par exemple sur « Grand Pianist », « The Song Is Love » et « Desiree », tube déjà présent chez Left Banke mais dont je préfère la version légèrement plus claire qu’en propose Montage.
Franchement c’est un album qui s’écoute limite comme une mixtape, les hits s’enchaînent sans effort, à chaque intro on se dit nan mais c’est pas possible, comment il fait, c’est un malade ce mec ! Et puis les morceaux ont l’élégance d’être tous très brefs, équilibrés entre lenteur et vélocité, c’est du boulot sur-mesure. Je vois ça comme une précision new-yorkaise injectée à cette musique qu’on assimile plutôt à l’Angleterre ou à la Californie, mais je dis sûrement n’importe quoi. En tout cas je pense pouvoir dire que c’est un disque qui ne sonne pas très 1969, si on le compare par exemple à des disques hyper intoxiqués sortis la même année comme The Velvet Underground ou The Stooges. Mais je vais arrêter de faire mon Philippe Manœuvre (pour lequel j’ai par ailleurs écrit sans le savoir les textes de cette série de podcasts très « wock’n’woll ») et je vous laisse découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, ce formidable disque plein de surprises et de moments de tendresse, un peu comme la vie.