L’autre jour, un ami et lecteur, en profond désaccord avec ma politique de soutien de la variété jazzy des années 80/90, m’a écrit un message après avoir lu mon article sur Louis Chédid. « Je te lance un défi, c’est de parler dans Musique Journal d’un chanteur que je déteste encore plus que Louis Chedid : Art Mengo, tu te souviens ? ». Cet ami visait juste, car il se trouve que j’ai redécouvert Art Mengo il y a deux ans et que je suis devenu fan d’une partie de son œuvre. J’adore principalement son premier album, Un 15 août en février, que le grand public connaît surtout pour le gros tube qu’était « Les parfums de sa vie (Je l’ai tant aimée) ». Mais en écoutant ce LP, on se dit le hit est peut-être le morceau le moins charmeur, sûrement parce qu’on l’a pas mal entendu et qu’on s’y est habitué, alors que les autres plages révèlent le style d’Art Mengo sous des nuances plus riches et étonnantes que ce que l’on pouvait croire.
Je vais m’autoriser une métaphore culinaire craignos, mais je trouve que le temps de cuisson de ce disque est parfait, et je crois aussi qu’il a reposé le bon nombre d’années avant d’être dégusté. D’ailleurs à ce niveau-là on peut carrément parler de temps de « garde » plutôt que de repos. L’album suivant, Guerre d’amour, s’il contient lui aussi des morceaux merveilleux, souffre d’une prod plus live mais bizarrement plus froide, limite stressante, et celui qui suivra La mer n’existe pas, où l’on trouve le tube du même nom et accessoirement l’une de ses plus belles chansons, fait le choix d’un son « haut de gamme » qui parfois alourdit le propos. Alors que sur Un 15 août, Art Mengo (qui s’appelle en vrai Michel Armengot) occupe une zone musicale idéalement située entre les références blues, rock et soul qui l’ont façonné, l’héritage d’une chanson française poétique et des arrangements synthétiques pas forcément très coûteux mais jamais dépourvus de panache et d’ambition. Il y a ce côté fin de journée méridionale, un été à Toulouse à la fin des années 80 (ce que j’en imagine, du moins), à ne rien faire de spécial dans un deux pièces aux volets restés fermés mais où il faut quand même encore 30 degrés, un trottoir arpenté au crépuscule dans l’espoir de recroiser une brune en robe à fleurs mais à l’air opaque, une volonté d’écrire des chansons denses quitte à être compliquées pour retranscrire cette ambiance qui plombe un peu mais qui laisse quand même flotter un parfum de vie qu’il faut absolument capter. C’est tout ça que m’évoque ce disque, réalisé entre autres avec Patrice Guirao (beau-frère du chanteur, qui co-écrit les paroles), Michel Vergine aux programmations et Jean Mora au synclavier (je ne sais pas trop ce que c’est mais je sens que c’est le genre d’instrument qui donne ce son hyper-réaliste que j’aime tant dans la musique de cette époque).
Alors évidemment, il y a la voix et l’élocution de Mengo, qui peuvent poser problème à certains. Souvent, le chanteur déforme la prononciation des mots pour les adapter au groove qu’il imprime à sa musique, et puis surtout il a tendance à ne jamais hésiter à y aller à fond dès qu’il s’agit de « sonner soul » ou de faire résonner son blues. Mais comment dire : est-ce un crime d’en faire des tonnes ? Si le mec a envie de se la donner parce qu’il juge que ça sert la sincérité de ses chansons, pourquoi faudrait-il l’en empêcher ? Du coup, certes, il faut se préparer aux nombreux murmures et halètements en fin de phrase, aux pauses sensuellement rugies, à ces brusques montées dans les aigus, tout ça au dessus d’un enchevêtrement de cordes réelles ou artificielles, de basses fretless ou slappées, de nappes de claviers richement enduites et de boîtes à rythmes jamais timides. Mais ce que j’aime, c’est que ces tics et cette prod théoriquement « à l’américaine » sonnent en fait on ne peut plus français : c’est une américanophilie totalement franco-centrée, une réappropriation de différents codes culturels et sonores qui surprendrait les Ricains.
Que l’on apprécie ou non le côté too much, ou, disons-le en français, le côté carrément « pas poss » du chant d’Art Mengo, on peut en revanche difficilement contester la beauté de ses compositions, des harmonies, des changements d’accords, des chants-contre-chants. On ne peut pas nier le soin passionné que Mengo et son équipe semblent avoir mis dans la production, afin de sortir ce disque chargé mais finalement très digeste, et surtout franchement jouissif à écouter, en tant que projet de variété un peu jeune, de son époque. C’est un disque de fan de musique qui reste encore fidèle à ses références mais qui découvre sous nos yeux son propre son, sa propre capacité à sortir de l’imitation tout en « se faisant kiffer » à chaque instant, comme il a kiffé quand il découvrait ses modèles.
Pour finir, il faut relever plusieurs choses intrigantes sur ce disque. Déjà, le morceau « Caïd Ali » était sorti en single alors que la Première guerre du Golfe avait commencé et visiblement ça avait fait débat : mais on se demande un peu pourquoi et comment ce texte très lyrique, assez « Télérama » dans le style, a pu déclencher la polémique, d’ailleurs si des témoins de l’époque le savent, qu’ils n’hésitent pas à se manifester. Autre détail curieux : sur le titre « Viens, je te hais », Mengo a intégré une sorte d’outro, ou plutôt un couplet détaché des autres, comme quand, à la fin d’un clip de rap, commence le début du single suivant comme un teaser, sauf que là le teaser ne se transforme pas en vraie chanson. Troisième chose intéressante : à la fin du dernier morceau de l’album, qui s’appelle « L’amour codé », Mengo fait un truc que je n’ai jamais entendu ni dans la chanson française ni ailleurs : il chante une sorte de medley de tous les autres titres de l’album, par mini extraits, en reprenant juste des bouts de refrains. On peut trouver ça prétentieux, genre le gars est tellement certain qu’il vient de nous sortir une suite ininterrompue de classiques qu’il va nous les rechanter vite fait pour qu’on comprenne bien son génie. Mais personnellement je prends plutôt ça pour une sorte de générique de fin, de bilan mignon en forme d’au revoir, comme une façon de dire qu’il a vraiment pris un pied énorme, comme on dit, à nous chanter tout ça avec son style de soulman toulousain qui en fait peut-être des tonnes, mais qui au moins croit en ce qu’il fait. Et puis, je sais que ce n’est pas volontaire de sa part, mais ça m’a tout de suite rappelé le sketch du Message à caractère informatif sur Francis Cabrel, et du coup j’ai à la fois rigolé et kiffé en découvrant cette audacieuse outro.
Art Mengo n’a pas chômé depuis ses débuts même si, comme le dit sa bio sur son site, il a préféré rester travailler comme un artisan chez lui plutôt que devenir une star de la chanson. Il a néanmoins beaucoup composé pour des artistes qui ont été des stars, de Johnny à Maurane en passant par Florent Pagny, Jane Birkin, Henri Salvador ou Juliette Gréco, mais aussi pour Philippe Léotard ou Viktor Lazlo. Au fil de ses albums solo, il a adouci ses tics soul et blues pour laisser s’épanouir sa belle voix, et honnêtement il y a des choses vraiment pas mal sur chacun d’entre eux, le genre de choses pas très éloignées de ce que peuvent faire les Innocents, qu’on est toujours content d’entendre à la radio, sur FIP ou ailleurs, quand on roule en bagnole. Mais le Art Mengo juvénile et pas poss est lui resté dans ce surprenant monde de torpeur et de désir qu’est Un 15 août en février.


![Musique Journal - Solos de 303, clavinova pour afters et soul française pécheresse [À la rencontre de divers aspects de la musique contemporaine, vol. 1]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2020/05/musique-journal-r-38870-1185466407.jpeg.jpg)
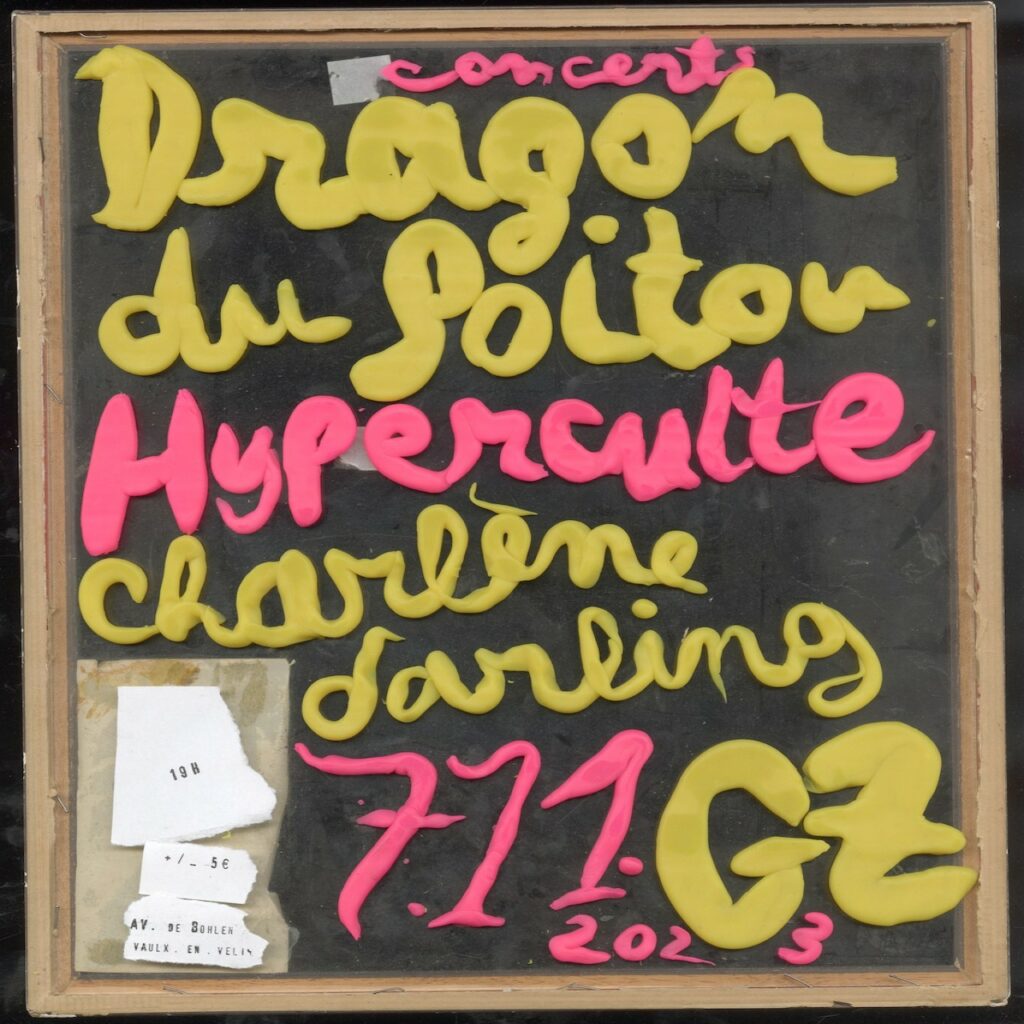
![Musique Journal - De la chanson réaliste sous le soleil breton [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2019/07/musique-journal-r-9938598-1488886211-4402.jpeg.jpg)